«Western bouillabaisse», quand l’Ouest américain s’importe en Camargue

Il était une fois dans l’ouest de l’Europe, des westerns. Au début IXXe siècle, quelques hommes œuvrent pour importer ce style cinématographie américain sur le territoire français, en Camargue. Un moyen de créer un pont culturel entre la Provence et l’Amérique.
« Western bouillabaisse », « western camembert » ou encore « western baguetti »… Plusieurs surnoms font référence à ce courant apparu au début du siècle dernier. À l’époque, le cinéma n’en est qu’à ses débuts. Les Lyonnais Lumières organisent la première projection publique d’un film à peine 15 ans plus tôt…
Décors rêvés
Les histoires venues du « Far West » sont déjà présentes dans l’imaginaire collectif. Avant le cinéma, la littérature autour de la Conquête de l’Ouest fascine. Des livres, mais aussi des spectacles. Le plus connu en Europe est le Wild West Show de Buffalo Bill. Une reproduction romancée mise en scène par de véritables témoins de ces cruelles guerres opposant colons européens et natifs des immenses paysages américains.

En Provence, un homme est particulièrement fasciné. Le Marquis Folco de Baroncelli reconnaît dans ses histoires une part de l’âme la Camargue, réputée pour sa rudesse où des hommes à cheval élèvent des taureaux sur d’immenses plaines aux allures désertiques.
Il y voit aussi un moyen de promouvoir le territoire. Sans hésiter, « le créateur de la Camargue » mandaté par Frédéric Mistral, se rend à Paris. Il y rencontre Buffalo Bill et Joë Hamman, un acteur français devenu pionnier dans le tournage de westerns outre-Atlantique.
D’Amérique à la Provence, le pari de Joe
En Europe, Joe s’essaye à quelques tournages en région parisienne. Mais, jouer les Cow-boys dans la forêt de Fontainebleau, ça ne prend pas. Folco de Baroncelli l’invite alors à s’essayer en Camargue, chez lui, aux Saintes-Marie-de-la-Mer.

C’est la révélation. Le Delta du Rhône est pour lui l’équivalent du no man’s land américain. Ensemble, entre 1909 et 1914, ils créent une vingtaine de ces films d’aventure. Gaumont en exporte certains jusqu’aux États-Unis où les critiques sont élogieuses.
« Notre Camargue rappelle certains coins de l’ouest lointain. Et puis les gardians, montés sur leurs petits chevaux camarguais, ne sont-ils pas, en quelque sorte, les frères des rudes cow-boys du Far West ? », écrit à ce propos Estelle Rouquette dans son livre Western camarguais.
Renaissance du style à l’après-guerres
Les guerres mettent fin à ses prouesses artistiques. Il faut attendre une cinquantaine d’années pour relancer la production. « La Camargue offre son décor naturel, sa lumière et ses figurants aux réalisateurs de films d’aventure.

Après Baroncelli, d’autres manadiers se prêtent au jeu d’intrigues mettant en scène des gardians, gitans et “Caraques blondes” stéréotypés », lit-on sur la présentation de l’exposition Westerns Camarguais lors des rencontres de la photographie à Arles, en 2016.
La Camargue apparaît comme une terre sauvage où la liberté fait droit. C’est dans l’esprit de l’époque. Crin-Blanc, les origines de la vie de Johnny Halliday ou celle d’Ulysse, le cheval de Fernandel, restent les références de ce style «frenchisé». Dans l’ensemble, ces films n’auront que peu de succès. À ce jeu, les « westerns spaghettis » des Italiens remporteront la palme.

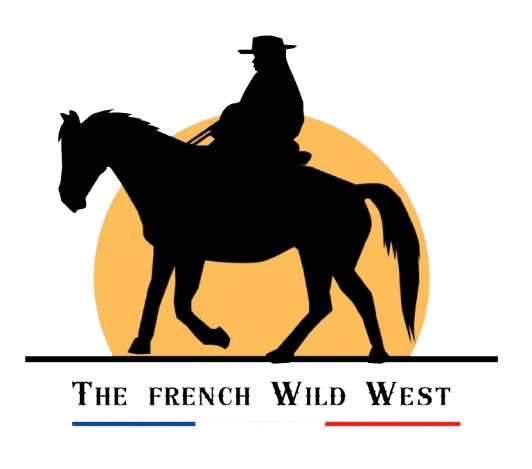
2 thoughts on “«Western bouillabaisse», quand l’Ouest américain s’importe en Camargue”